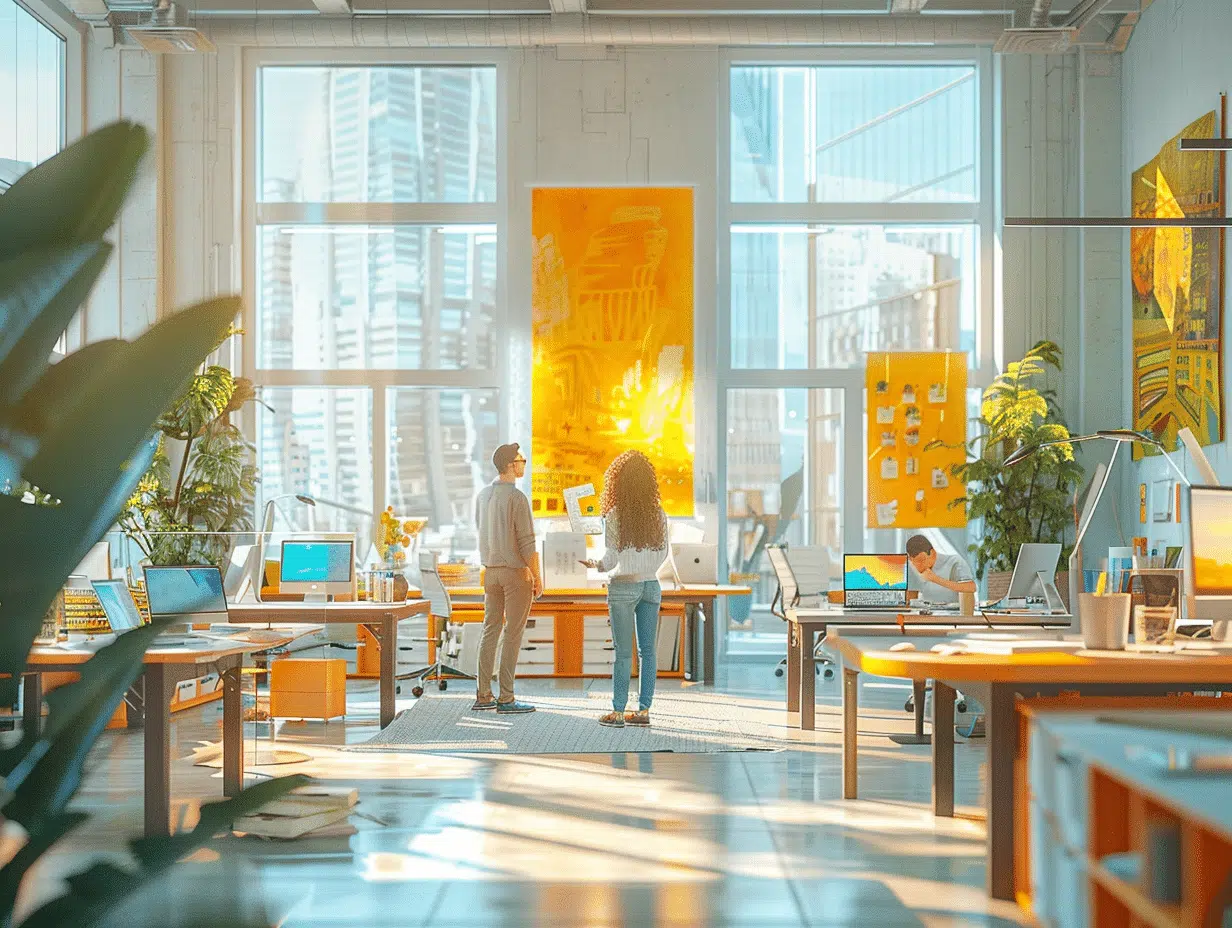Un veto de la Commission européenne suffit à bloquer une fusion entre deux géants industriels, même si les États membres concernés y sont favorables. Le règlement (CE) n° 139/2004 confère à la Commission des pouvoirs exclusifs pour examiner les opérations de concentration de dimension européenne, en dehors de toute intervention directe des juridictions nationales.
La réforme de 2023 sur le filtrage des investissements étrangers a renforcé le contrôle des acquisitions pouvant menacer la sécurité ou l’ordre public de l’Union. De nouveaux débats émergent au Parlement européen, remettant en question la transparence et l’efficacité de ces mécanismes. Les équilibres institutionnels restent fragiles face à la montée des enjeux géopolitiques.
Le contrôle des concentrations en Europe : un enjeu central pour la concurrence
Sur le terrain des grandes manœuvres industrielles, la Commission européenne garde l’œil sur chaque fusion ou rachat capable de bousculer la concurrence dans le marché intérieur. Dès que l’opération atteint les seuils de contrôle établis par Bruxelles, impossible pour les entreprises d’y couper : il faut passer par la case notification. L’examen est minutieux, rien ne passe sous silence. Entretiens avec les acteurs du secteur, radiographie du marché, examen du risque de position dominante, le dossier est passé au crible.
Certains secteurs attirent tout particulièrement l’attention. Dans la santé, les biotechnologies ou l’économie numérique, les autorités redoutent les killer acquisitions : ces rachats de start-up encore émergentes par des mastodontes, pour neutraliser toute menace concurrentielle. Difficile de ne pas voir la tentation : s’approprier une innovation avant qu’elle ne devienne gênante. Même vigilance dans les univers du logiciel de création interactive, du matériel ferroviaire ou de l’énergie : la diversité et la souveraineté du marché européen sont en jeu.
Pour limiter les effets de concentration, la commission choisit entre deux grandes catégories de solutions, chacune adaptée à la situation :
- Remèdes structurels : obligation de vendre certains actifs, voire de diviser des branches entières pour éviter une position trop dominante ;
- Remèdes comportementaux : engagements à ouvrir des plateformes, garantir un accès équitable aux infrastructures, ou encore préserver l’accès à l’innovation.
Le gun jumping, cette prise de contrôle avant feu vert officiel, n’échappe pas à la vigilance de Bruxelles. Les sanctions pleuvent dans l’automobile, les infrastructures routières ou les tests sanguins de détection précoce du cancer dès lors qu’une entreprise tente de précipiter les synergies. Chaque faux pas se paie au prix fort.
Qui surveille vraiment les opérations de fusion et d’acquisition ?
La Commission européenne occupe le premier rang dans la surveillance des concentrations sur le marché intérieur. Si un dossier dépasse les seuils de concentration d’entreprises au niveau de l’Union, elle en prend la main. Mais la vigilance ne s’arrête pas à Bruxelles. Les autorités nationales de concurrence, à l’image de l’instance française, ont les moyens d’examiner les opérations qui passent sous le radar européen, notamment dans les marchés plus restreints ou aux spécificités locales.
Quand un désaccord éclate, le tribunal de l’Union européenne et, en dernier recours, la Cour de justice de l’Union européenne tranchent. Leur rôle ne se limite pas à vérifier la conformité des procédures : elles évaluent la solidité de l’analyse économique, la logique des remèdes structurels ou comportementaux imposés, et font évoluer la jurisprudence, dossier après dossier, notamment sur le gun jumping et les règles de notification.
Le filtrage des investissements directs étrangers complète ce dispositif. Piloté par la commission et les États membres, il vise à protéger la sécurité et l’ordre public, surtout dans des domaines jugés stratégiques comme l’énergie, la santé ou les technologies de communication. Les entreprises qui jouent avec les règles, en omettant des informations ou en tentant de passer en force, s’exposent à des sanctions parfois lourdes.
Voici les rôles principaux répartis entre les institutions :
- Commission européenne : contrôle des plus grandes concentrations, coordination des politiques nationales.
- Autorités nationales : surveillance ciblée des opérations locales, mise en œuvre des sanctions.
- Juridictions européennes : interprétation des textes et examen de la proportionnalité des mesures adoptées.
Commission européenne et nouvelles réglementations : quelles évolutions pour les investissements internationaux ?
Depuis 2019, la Commission européenne s’appuie sur un mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers. Son objectif est limpide : repérer toute opération susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public dans l’Union. Si les États membres gardent la main sur l’analyse, Bruxelles joue les chefs d’orchestre en centralisant les signalements et en diffusant l’information. L’approche est collective, loin des réflexes de repli.
Le règlement sur les subventions étrangères vient ajouter une nouvelle dimension. Désormais, toute entreprise bénéficiant d’un soutien étatique extérieur à l’Europe doit détailler la nature et le montant de ces aides lors d’une acquisition ou d’un appel d’offres. Cette transparence accrue donne à la Commission du commerce international un pouvoir d’enquête renforcé, jusqu’à la possibilité de bloquer une opération si une distorsion de concurrence est avérée.
Autre évolution notable : le champ d’application de l’article 22 du règlement sur les concentrations s’étend. Il autorise désormais les autorités nationales, en lien avec la commission, à exiger un examen de dossiers qui ne franchissent pas les seuils classiques. Secteurs de la biotechnologie, de la santé ou du numérique sont dans le viseur, particulièrement exposés au risque de killer acquisitions qui visent à museler la concurrence naissante.
Trois axes structurent ces nouvelles règles :
- Règlement sur le filtrage des investissements : coordination renforcée entre États.
- Contrôle des subventions étrangères : transparence accrue sur les aides publiques extra-européennes.
- Extension de l’article 22 : surveillance adaptée aux investissements jugés stratégiques.
Débats actuels au Parlement européen : vers un renforcement du contrôle des concentrations ?
À Strasbourg, le ton monte. Parlement européen et Commission du commerce international s’interrogent sur la robustesse des outils en place face à la montée des concentrations d’entreprises. Plusieurs voix appellent à revoir les seuils de notification et à redoubler d’attention concernant les killer acquisitions, ces rachats menés sans éclat, mais qui peuvent étouffer l’innovation, notamment dans l’économie numérique ou la santé.
Les angles morts du système sont scrutés. Plusieurs États membres, France, Allemagne, mais aussi des pays d’Europe centrale, souhaitent élargir le spectre du filtrage des investissements étrangers. La question de l’équilibre revient sans cesse : comment maintenir l’ouverture du marché intérieur tout en protégeant la sécurité et l’ordre public ? Le contrôle des subventions étrangères attise aussi les discussions. Impossible pour Bruxelles de tolérer que certains champions s’appuient sur des aides venues de l’extérieur pour fausser la concurrence.
Points de friction identifiés
Parmi les sujets qui cristallisent les tensions, on retrouve notamment :
- Harmonisation du contrôle entre États membres et Commission européenne
- Transparence accrue sur l’identité des investisseurs extra-européens
- Capacité à détecter et anticiper les stratégies d’évitement des seuils réglementaires
Les auditions s’enchaînent, les rapports s’accumulent. Une préoccupation domine : ne pas laisser le contrôle se diluer, ni baisser la garde face aux géants venus des États-Unis ou de Chine. Plusieurs élus réclament une révision rapide du règlement, s’appuyant sur les leçons tirées des dernières affaires, notamment dans les biotechnologies et le secteur du matériel ferroviaire.
Les lignes bougent, les débats s’intensifient. La question n’est plus seulement de savoir qui contrôle la Commission du commerce international, mais jusqu’où l’Europe veut, et peut, aller pour préserver un marché à la fois ouvert et souverain. Demain, les arbitrages se feront sans doute à la lumière de nouveaux rapports de force. Qui osera encore avancer sans regarder par-dessus son épaule ?